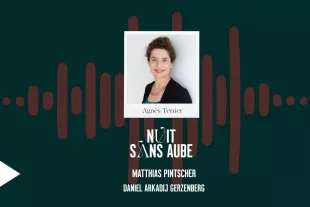Nous sommes à Berlin vers 1820. La saison du Théâtre royal affiche Don Giovanni qui est, depuis trente ans, l’opus mozartien préféré des Berlinois. Entre les deux actes du dramma giocoso, les messieurs du parterre se précipitent dans la taverne attenante. C’est là que le compositeur et poète E. T. A. Hoffmann attend la Stella, interprète du rôle de Donna Anna. Il connaît le spectacle par coeur et préfère, dans la fumée des pipes et les vapeurs de l’alcool, rêver à ses amours passées, préoccupé qu’il est par les admirateurs de sa diva. Ses amis ont tôt fait d’extorquer des confessions à ce conteur invétéré. Le second acte commencera sans eux. Mais à la fin du spectacle, Stella, vexée, abandonnera Hoffmann à sa griserie.
En 1851, Michel Carré et Jules Barbier, un jeune duo d’auteurs, élaborent cette fiction afin de donner forme à un « drame fantastique » basé sur l’artiste allemand, mort trente ans plus tôt. Ses contes, sitôt traduits, sont devenus un phénomène de librairie dont ils entendent profiter. Leur idée : tirer de son oeuvre trois intrigues sentimentales, chacune campée dans un décor spécifique, dont le protagoniste masculin se confondra avec son auteur. Leur pièce présente donc à la fois la figure emblématique du romantisme allemand et ses plus fameux récits : « L’Homme au sable », « Le Violon de Crémone » et « L’Histoire du reflet perdu ». Avec en prime l’insertion d’un personnage créé par un ami d’Hoffmann (Chamisso) : Peter Schlemihl, « l’homme qui a vendu son ombre au diable » (conte de 1814).
Pour épargner l’aura d’Hoffmann, Barbier et Carré lui adjoignent un compagnon étudiant, Nicklausse, qui est en réalité sa Muse : issue des Nuits d’Alfred de Musset (1838), elle se dévoilera au dénouement pour le rappeler à son art.
Au printemps 1851, cet habile montage, qualifié de « drame fantastique », fait sensation au Théâtre de l’Odéon. Puis il est adapté en livret d’opéra pour Hector Salomon (1838-1906), chef de chant au Théâtre-Lyrique. La partition, terminée en 1866, est destinée au Théâtre de la Porte Saint-Martin où l’on exploite le registre fantastique. Mais elle reste dans le tiroir de Salomon faute de soprano capable d’interpréter les rôles féminins. Car, comme dans le drame, le livret repose sur la mise en réseau des personnages : toutes les femmes aimées, tous les adversaires d’Hoffmann et tous les valets comiques sont joués par la ou le même interprète, d’un acte à l’autre. Comme pour enfermer Hoffmann dans sa fantaisie.
En 1873, Barbier (Carré est décédé) cède à Offenbach les droits du livret. Le célèbre compositeur, qui dirige alors le Théâtre de la Gaîté, se sent talonné par de jeunes rivaux comme Charles Lecocq. Il « écrit à la vapeur » (selon L’Art musical) pour diverses scènes parisiennes, sa « fièvre de production » donnant lieu à plusieurs créations par an. Il destine Les Contes d’Hoffmann à l’Opéra-Comique où ses Barkouf (1860), Robinson Crusoé (1867), Vert-Vert (1869) et Fantasio (1872) n’ont pas connu de véritable succès. Mais la valse des directeurs ajourne ses espoirs.
En 1877, Offenbach s’installe au 8, boulevard des Capucines, près du Grand Opéra (Garnier). Il compose Les Contes d’Hoffmann entre cette adresse chic et le Pavillon Henri IV, bel hôtel situé au vert sur la Terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Comme le Théâtre-National-Lyrique (rouvert à la Gaîté) se positionne, Les Contes sont préfigurés en « opéra fantastique ». Lorsque son directeur dépose le bilan, Offenbach négocie avec le Théâtre impérial de Vienne qui, en février 1879, donne la version allemande de Madame Favart.
Ses amis viennois, qui ne l’ont pas vu depuis trois ans, sont choqués : Offenbach est « semblable à une ruine » (Hanslick). Épuisé par la goutte, enveloppé de fourrures, parfois en chaise roulante, hanté par la mort, il travaille d’arrache-pied. Hoffmann le ramène au romantisme allemand, ranime ses rêves juvéniles, la nostalgie de son pays natal, sa vocation profonde. S’il a toujours instillé du sérieux et de la poésie dans ses comédies, il les met à présent au centre de cet opéra qu’il veut testamentaire. « Tout ce que je demande, c’est de vivre jusqu’à la première. » Mais en parallèle, il mène à terme La Fille du tambour-major pour les Folies-Dramatiques et entame Belle Lurette pour la Renaissance.
Le 18 mai 1879, il organise chez lui une audition publique des neuf numéros des Contes déjà prêts – dont la Barcarolle, en réalité prélevée dans ses Rheinnixen de 1864. Des solistes de l’Opéra-Comique sont mobilisés. Devant le succès, leur directeur Léon Carvalho s’engage à monter l’oeuvre. « Un fils de Weber nous est né boulevard des Capucines, en plein Paris ! » lit-on dans Le Ménestrel qui ajoute : « Le fantastique lui est chose connue. » En effet, Offenbach a su jouer de l’inquiétude suscitée par sa virtuosité au violoncelle, son humour et son physique étrange, tant caricaturé, au point que Flaubert a intégré à son Dictionnaire des idées reçues une entrée OFFENBACH : « Dès qu’on entend son nom, il faut fermer deux doigts de la main droite pour se préserver du mauvais oeil. »
Offenbach doit transformer son opéra en opéracomique (remplacer les récitatifs par des dialogues) et s’adapter à la distribution voulue par Carvalho, qui valorise ses vedettes. Hoffmann ne sera pas baryton mais ténor ; les rôles féminins seront chantés par une colorature. Ce sont Talazac et Adèle Isaac, qui viennent de triompher dans Roméo et Juliette de Gounod. L’excellent baryton Taskin, la jolie mezzo Marguerite Ugalde et le ténor de caractère Pierre Grivot, fidèle d’Offenbach, complètent la distribution.
L’été 1880 est studieux mais Offenbach ne peut ni achever la composition ni entamer l’orchestration des Contes. Tandis que la salle Favart affiche Le Domino noir d’Auber et Jean de Nivelle de Delibes, les répétitions débutent le 11 septembre. Offenbach ne s’y rend que deux fois. Avant de s’éteindre le 5 octobre.
Dans la foulée des obsèques du 7 à la Madeleine, où chantent Talazac et Taskin, le compositeur Ernest Guiraud est invité à achever la partition, en particulier l’orchestration (il composera aussi des récitatifs pour une version opéra), tandis que Delibes termine Belle Lurette qui est créée à la fin du mois. À l’issue d’une prégénérale des Contes, le 1er février 1881, Carvalho décide de supprimer l’acte de Venise qu’il trouve plus féerique que dramatique. La barcarolle et des fragments du duo Hoffmann-Giulietta sont replacés ailleurs dans l’oeuvre.
Dirigée par Jules Danbé, la création du 10 février 1881 remporte un triomphe devant le tout-Paris. Les décors de Lavastre, les costumes de Thomas et l’abattage de la troupe sont à la hauteur de la partition. « Je doutais qu’une oeuvre sérieuse sorte jamais de la plume qui a écrit les excentricités d’Orphée aux Enfers. Eh bien ! je me suis trompé ! » s’exclame le très sérieux Ernest Reyer (Journal des débats). On s’accorde à reconnaître la dimension intime de l’opéra, autoportrait déchiffrable à travers un portrait d’Hoffmann lui-même enchâssé... dans une représentation… de Mozart. Tandis que l’éditeur Choudens publie la partition avec l’acte de Venise, l’oeuvre est jouée jusqu’à l’été, puis reprise la saison suivante, qui voit aussi le 7 décembre 1881 la création de la version allemande à l’Opéra de Vienne. Malheureusement, ce théâtre brûle… le lendemain. Il en ira de même de l’Opéra-Comique au printemps 1887, après 133 représentations des Contes. Chaque sinistre engloutit des documents de première main.
Entretemps l’oeuvre a été créée à Genève, New York et Mexico (1882), Prague et Anvers (1883), Berlin (1905) par le Komische Oper qui l’emmène à Londres en 1907, etc. Pour la remonter, l’Opéra de Vienne attend 1901 sous la direction de Gustav Mahler, et l’Opéra-Comique 1911 sous la direction d’Albert Wolff – avec l’acte de Venise cette fois.
Désormais Les Contes sont régulièrement joués salle Favart et six productions se succèdent jusqu’en 1997 (en 1974, ils entrent au répertoire de l’Opéra, montés par Georges Prêtre et Patrice Chéreau). Les versions varient en l’absence de partition définitive. En 1904, elles ont intégré dans le rôle de Dapertutto la chanson « Scintille diamant », tirée de l’ouverture du Voyage dans la lune par Raoul Gunsbourg. À Favart, Nicklausse est chanté par un homme de 1938 à 1972 ; la Muse est interprétée par une comédienne ; les rôles féminins sont tenus par des chanteuses différentes.
n 2025, après trente ans d’absence, le 10e titre le plus joué à l’Opéra-Comique revient sous sa forme opéra-comique dans une version établie par le chef d’orchestre Pierre Dumoussaud d’après l’édition critique de Jean-Christophe Keck. Il est servi par une distribution resserrée conforme au voeu d’Offenbach, et mis en scène par Lotte de Beer avec de nouveaux dialogues parlés. Elle adopte sur l’action le point de vue de la Muse, divinité travestie en étudiant pour éclairer l’artiste perdu dans ses fantasmes, entre femmes rêvées et démons intérieurs.
La boîte scénique et l’esprit du créateur, s’ouvrant devant nous, ne font plus qu’un : n’est-ce pas fantastique ?
Par Agnès Terrier, dramaturge de l'Opéra-Comique
J’ouvre le Kreisleriana du divin Hoffmann, et j’y lis une curieuse recommandation : le musicien consciencieux doit se servir du vin de Champagne pour composer un opéra‑comique. Il y trouvera la gaieté mousseuse et légère que réclame le genre
Baudelaire Les paradis artificiels, 1860
Argument
Acte I
Dans la taverne de Luther, qui jouxte l’Opéra de Berlin, une joyeuse compagnie se rassemble à l’entracte d’une représentation du Don Giovanni de Mozart. C’est là que la Muse vient prendre en charge Hoffmann, un poète que l’amour détourne du travail. Pour l’heure, il attend la diva Stella, qui interprète le rôle de Donna Anna. La Muse prend l’apparence d’un ami d’Hoffmann, Nicklausse, et entreprend de manipuler un convive inoffensif, le conseiller Lindorf. Lindorf découvre que Stella a fixé rendez-vous à Hoffmann et en conçoit de la jalousie. Hoffmann chante à l’assistance la chanson de Kleinzach et son esprit s’égare en cours de route. Il nie être amoureux, mais Lindorf l’asticote. Hoffmann s’exalte et propose de raconter trois de ses amours avant que l’opéra ne prenne fin.
Acte II
Jeune étudiant en physique, Hoffmann est tombé amoureux d’Olympia, la fille du professeur Spalanzani. L’opticien Coppélius lui vend des lunettes qui lui font voir Olympia plus aimable encore. Lors d’une soirée que Spalanzani organise pour la présenter à la bonne société, Olympia effectue un brillant numéro de chant. Hoffmann ose lui déclarer sa flamme et, négligeant les avertissements de Nicklausse, ouvre le bal avec elle. La mécanique s’emballe tandis que Coppélius, furieux, vient dénoncer les malversations de Spalanzani. L’automate se détraque, Hoffmann en accuse le diable.
Acte III
Hoffmann a ensuite aimé une jeune musicienne mais son père, le luthier Crespel, a tenté de les séparer. Hoffmann la retrouve et si sa promesse de l’épouser l’enthousiasme, il s’inquiète de sa passion pour la musique. Pourquoi son père interdit-il à Antonia de chanter ? Que lui veut le Docteur Miracle avec ses remèdes ? Est-elle malade ? Pour inciter Antonia à chanter, Miracle lui promet le succès, puis fait apparaître sa mère, grande cantatrice défunte. Antonia croit pouvoir unir l’amour au chant et succombe.
Acte IV
Hoffmann est parti s’étourdir à Venise, dans la société de la courtisane Giulietta. Il ne l’aime pas, ce qui rassure Nicklausse. Mais le diabolique capitaine Dapertutto manipule Giulietta : pour quelques bijoux, elle séduit des hommes auxquels elle dérobe leurs reflets. Lors d’une soirée de jeu, elle conquiert facilement Hoffmann. Pour récupérer sa clé, Hoffmann affronte son amant Schlémil, lequel a sacrifié son ombre. Il le tue avec l’aide de Dapertutto. Meurtrier, il doit quitter la ville. Giulietta obtient qu’il lui laisse son reflet en souvenir. Puis elle le rejette publiquement. Furieux, Hoffmann tue son amant favori, l’affreux Pitichinaccio, et s’enfuit.
Acte V
Dans la taverne, Hoffmann émerge de ses souvenirs et ne reconnaît plus Stella à sa sortie de scène. Furieuse, elle le quitte. Nicklausse se démasque alors : la Muse l’incite à se mettre au travail. Il ne lui reste plus qu’à coucher ses souffrances par écrit.