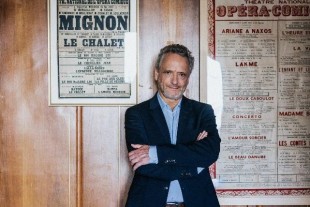Le 9 janvier 1753, la création du Titon et l’Aurore de Mondonville à l’Académie Royale de Musique, ou Opéra (ancêtre de l’actuel Opéra de Paris) coïncide avec la phase aigüe d’un débat esthétique qui enfle depuis quelques mois et ne se terminera qu’au printemps 1754 : la « querelle des Bouffons ». Ce n’est pas la première querelle de goût qui secoue ainsi le monde lyrique français. Déjà en 1733, les « lullystes » et les « ramistes » défendaient deux esthétiques différentes de l’opéra – les premiers reprochant aux seconds d’aimer le raffinement et la complexité de la musique italienne, dénaturant la tradition de l’opéra français.
Sur le fond de cette éternelle comparaison entre les arts italien et français, la nouvelle polémique oppose un genre noble et sérieux (la tragédie lyrique française) à un genre comique visant l’expression naturelle (l’opera buffa italien). Les querelleurs se disputent au parterre de l’Opéra et à coups de pamphlets pas toujours signés. Ils confrontent le répertoire consacré de l’institution avec les spectacles d’opera buffa que la troupe italienne d’Eustachio Bambini, invitée par l’Opéra, y donne depuis le mois d’août 1752 – ce sont les fameux « Bouffons » italiens, qui donnent leur nom à cette querelle. La cohabitation des genres et des langues est une première sur la scène royale.
L’Opéra, depuis le 28 juin 1669, possède en effet le privilège de faire représenter des spectacles chantés en langue française, et détient ce monopole sur l’ensemble du royaume. Les quelques 160 représentations par an (en moyenne), données les mardis, vendredis et dimanches, constituent progressivement le répertoire de l’opéra français : il s’agit de tragédies lyriques, de ballets héroïques et de pastorales. L’introduction des intermèdes italiens par les directeurs Rebel et Francoeur est donc une première tout autant qu’un événement.
Deux camps se dessinent alors : ceux que l’on nomme désormais les « bouffonistes », dont le clan rassemble philosophes et encyclopédistes, soutiennent dans leurs écrits et dans la presse les intermèdes proposés par la troupe d’Eustachio Bambini, notamment la Serva padrona de Pergolèse. Ils se regroupent sous la loge de la Reine Marie Leczinska, à droite de la scène, pour montrer par la même occasion leur désaccord profond avec la monarchie de Louis XV qui vient de censurer la parution de l’Encyclopédie.
De l’autre côté, les partisans de l’art français se tiennent sous la loge du Roi, et prennent Mondonville et son Titon et l’Aurore pour fers de lance. Ils vont assurer le triomphe de l’œuvre et s’attaquent aux « bouffonistes » qui font le jeu de l’Italie et sapent la tradition musicale française héritée de Lully. Pour eux, il s’agit avant tout de sauver un genre et la dignité de l’opéra français.
Dans un contexte de censure monarchique, la querelle prend également un tour politique et identitaire. Dans le système de l’Ancien Régime, l’Opéra est l’institution dans laquelle se construit une image artistique de la royauté française. Être du coin du Roi, c’est associer l’opéra français à une « identité nationale française » et la défendre ; être pro-italien, c’est remettre en cause ce schéma - et donc l’autorité du monarque.
Entre l’été 1752 et la fin du printemps 1754, plus de soixante pamphlets vantant les mérites, qui de l’opéra français, qui de l’opéra italien, qui des Bouffons, sont publiés, souvent sous des noms d’emprunt. Les discussions esthétiques sur l’opéra sont toujours plus ou moins latentes, mais certains événements ou publications mettent le feu aux poudres : la Lettre sur Omphale de Grimm, l’arrivée de la troupe de Bouffons de Bambini, la création de Titon et l’Aurore, la Lettre sur la musique française de Rousseau…
Nous avons choisi de vous présenter les morceaux les plus mordants de cette querelle d’intellectuels - pour un accès intégral aux pamphlets et à leur chronologie, vous pouvez vous reporter au document « Tableau chronologique de la Querelle des Bouffons » dans l’onglet « ressources ».
La création de Titon et l'Aurore en pleine querelle
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Pastel de Maurice-Quentin de La Tour, collection du musée Antoine Lécuyer (Saint-Quentin)
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
L'amour invoqué par l'Aurore en faveur de Titon
Par Antoine Boizot, 1753, Collection des musées de Poitiers
© Musées de Poitiers / Christian Vignaud L’Amour invoqué par l’Aurore en faveur de Titon
Le baron de Grimm
Anonyme, New York Public Library, Muller Collection
© New York Public Library Le baron de Grimm
« Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, ancien maître de musique de la chapelle du roi, vient de mourir. Ce fut lui qui fit perdre aux partisans de la musique italienne et des Bouffons le champ de bataille à l’Opéra, il y a tout juste vingt ans. Une mauvaise troupe de Bouffons d’Italie avait fait tomber successivement avec ses intermèdes tous les opéras français qu’on avait exposés à l’admiration publique. Le péril était instant ; encore une chute et c’était fait peut-être du théâtre de l’Académie royale de musique. C’est dans cette conjoncture délicate et dangereuse que Mondonville risqua son opéra de Titon et l’Aurore, ouvrage plat et misérable s’il en fut jamais, mais que la Providence divine dont les décrets sont impénétrables choisit, pour bannir de l’Opéra de Paris le génie de Pergolesi et de tant d’autres grands hommes d’Italie.
On négocia d’abord avec le Coin de la Reine : on appelait ainsi les partisans de la musique italienne, parce qu’ils s’assemblaient à l’Opéra dans le parterre sous la loge de la reine. Ce Coin était alors fort à la mode, et composé de tout ce que la nation avait de plus célèbre dans les lettres et dans les arts, et de plus aimable parmi les gens du monde. Les émissaires de Mondonville venaient en suppliants. Ils assuraient le Coin du profond respect de l’auteur pour ses oracles, et de l’admiration sincère qu’il avait pour la musique italienne. Ils promettaient en son nom et juraient dans son âme que si le Coin voulait bien laisser réussir Titon et l’Aurore, sa première marque de reconnaissance serait de composer un opéra dans le goût italien : le pauvre diable de Mondonville aurait été fort embarrassé d’être pris au mot : il ne composait que dans le goût plat. Cette négociation amusa longtemps le Coin qui était composé de fanatiques de bonne foi et de néophytes aussi zélés que Polyeucte, toujours près d’abattre les idoles de l’ancienne religion, et de fanatiques gens d’esprit, passionnés à la vérité pour la musique italienne, mais prenant tout gaiement et préférant un quart d’heure de bonne humeur à toutes les extases du monde.
Le Coin se forma plus d’une fois en grand comité sur la requête de Mondonville, tantôt sous la présidence de d’Alembert, tantôt sous celle de l’abbé de Canaie. Il y eut des avis très-motivés. Les uns étaient disposés à accorder au suppliant sa demande, sans tirer à conséquence : les autres opinaient pour une chute complète, pure et simple, comme si elle eût dépendu de leur avis. Mondonville en négociant avec le Coin, ne perdit pas de vue ses autres ressources. Il se fit un puissant parti à Versailles, où sa souplesse et ses intrigues lui avaient procuré beaucoup de protecteurs. Il leur persuada que c’était moins son affaire que celle de la nation. Le patriotisme se réveilla. Madame de Pompadour crut la musique française en danger, et frémit. On résolut de faire réussir l’opéra de Titon et l’Aurore, à quelque prix que ce fût. Toute la maison du roi fut commandée.
Le jour de la première représentation, dès midi le Coin de la Reine fut occupé par MM. les gendarmes de la garde du roi; MM. les chevau-légers et les mousquetaires remplissaient le reste du parterre. Lorsque MM. du Coin arrivèrent pour prendre leurs places, ils ne purent en approcher, et furent obligés de se disperser dans les corridors et au paradis où, sans rien voir, ils furent témoins des applaudissements les plus bruyants qu’on eût jamais prodigués à une première représentation. Un courrier fut dépêché à Choisy, où était le roi, pour porter la nouvelle du succès. Notre défaite fut complète. On osa bientôt aller plus loin, et congédier la troupe de Bouffons, source de tant de discorde, et cela se fit si heureusement qu’on n’a pas entendu chanter une seule fois depuis sur le théâtre du Palais-Royal, et qu’on y crie jusqu’à ce jour avec une force de poumons que le patriotisme national peut seul endurer ».
Baron de Grimm, Mémoires historiques, littéraires et anecdotiques (publiés pour la première fois en 1814).
Friedrich Melchior, baron de Grimm (1723-1807), originaire de Ratisbonne, installé à Paris depuis 1748, critique littéraire, collaborateur de l’Encyclopédie et directeur de La Correspondance littéraire (publication culturelle de diffusion européenne), de laquelle sont extraites ses Mémoires historiques, littéraires et anecdotiques. Grimm y partage les anecdotes de sa vie parisienne d’intellectuel européen.
Il relate la création de Titon et l’Aurore le 9 janvier 1753 dans des conditions d’effervescence générale sans doute exagérées pour son récit, de même qu’il caricature la posture du compositeur Mondonville, décédé à l’heure où Grimm écrit, comme chef de rang du camp anti-italien.
UNE GUERRE DE PAMPHLETS
Printemps-été 1752 – Contestation de l’opéra français
« Je n’ignore pas que toutes les fois qu’il est question de leur musique, les Français refusent nettement la compétence à tous les autres peuples et ils ont leurs raisons pour cela. Cependant quand ces mêmes Français nous assurent que la musique chinoise est détestable, je ne crois pas qu’ils se soient donné la peine de prendre l’avis des Chinois pour prononcer ce jugement ».
« J’arrive à Paris aussi prévenu contre votre Opéra que le font tous les étrangers. J’y cours, bien sûr de le trouver plus mauvais encore que je ne me l’étais figuré ».
« Je prévois que les partisans d’Omphale m’abandonneront bien des parties de cet opéra, et surtout celle qu’on appelle la musique par excellence. Ils conviendront qu’il n’y faut point chercher de savoir ni de richesses, ni d’harmonie. Ils me parleront du goût, du naturel et de l’expression qui sont dans le chant de cet opéra, et c’est précisément sur ces choses-là que je veux l’attaquer. Selon moi le chant est de mauvais goût, et rempli de contresens, triste, sans aucune expression, toujours au-dessous de son sujet, ce qui est le pire de tous les vices ».
« En général il n'y a pas dans l'opéra entier, un seul air de caractère, & l'on n'y en doit pas chercher : il n'appartient peut-être qu'à M. Rameau de donner de la physionomie à tout ce qu'il peint ; mais on a droit d'exiger que chaque Air soit un, au lieu que dans Omphale ce n'est jamais qu'une rapsodie de phrases de musique, quelquefois agréables, cousues l'une à l'autre, sans rapport, sans liaison & sans dessein. »
« S'il vous arrivait, Madame, de vous promener un jour pendant la Foire de Leipzig dans le Faubourg de St Pierre, vous trouverez dans votre chemin sur une banquette un aveugle vénérable par sa vieillesse, qui montre sa toile, qu'il ne voit point, & qui chante avec beaucoup d'expression des paroles tudesques, à la vérité, mais plus convenables au caractère du chant. Au reste, c’est au gens de l’art à examiner mon sentiment sur ce point, et à décider si en effet le récitatif mesuré répond mal à la majesté de la tragédie, et s’il ne faut point peut-être le reléguer dans le ballet et dans la pastorale.
(…) Comment les mêmes Spectateurs qui ont applaudi ce chef - d'œuvre ce divin Pygmalion la veille, osent marquer le lendemain le moindre plaisir à Omphale ? Mais il n'est pas difficile de rendre compte de ces contradictions. C'est aux philosophes & aux gens de lettres que la nation doit, même sans s'en douter, son goût devenu depuis peu général pour la bonne musique, ainsi que pour tous les beaux-arts. C'est à eux les éloges que M. Rameau doit principalement la justice et les honneurs que toute la nation lui rend aujourd'hui. Mais la nature & l'instinct font dans un seul jour en Italie & ailleurs plus de prosélytes au bon goût, que les philosophes n'en font ici par leurs dissertations en plusieurs années. Ce goût, quoi que général en France, est encore vague, il est souvent balancé par de vieux préjugés qui semblent respectables par leur faiblesse même, comme quelquefois la vieillesse n’a d’autre titre à la considération de sa décrépitude. C’est encore aux philosophes et aux temps de fixer ce goût et de le rendre sûr chez la nation. Dans dix ans d’ici le magasin de l’Opéra se débarrassera de bien de prétendus trésors et il ne sera pas plus pauvre que cela. (…) L’autorité et le crédit des gens de lettres avanceront sans doute ce terme si glorieux pour la France ».