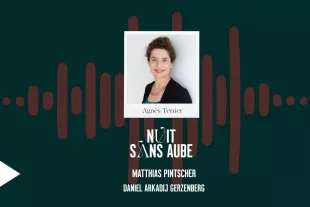Charles Gounod - Portrait dans les années 1860
« Il aimait à discourir sur les sujets mystiques ; son érudition était solide, sa parole entraînante, son regard vous fascinait. Et il avait dans toute sa physionomie un charme irrésistible – c’était un charmeur dans toute l’acception du mot. On lui pardonnait l’exubérance de ses flatteries et de ses caresses parce qu’au fond il était serviable et bon. »
Ernest Reyer Journal des débats, 28 octobre 1893
Né à Paris le 17 juin 1818, Charles Gounod était le fils du peintre François Gounod et le petit-fils du dernier « fourbisseur » du Roi (armurier). Les artisans étant logés dans la galerie du Louvre au même titre que les artistes attachés à la couronne, leurs enfants jouaient ensemble et c’est ainsi que la famille Gounod s’est intégrée au milieu artistique le plus en vue.
Otello de Rossini au Théâtre-Italien avec la Malibran en 1831 puis Don Giovanni en 1833 susciteront sa vocation de compositeur. Élève de Reicha en privé puis, au Conservatoire, de Lesueur et d’Halévy, Gounod remporta le premier Grand Prix de Rome en 1839 avec la cantate Fernand. Les deux années passées à la Villa Médicis furent marquées par son intimité avec Ingres, dont les propos (« le dessin est la dignité de l’art ») lui apprirent davantage que ses études de composition ; et par la découverte, à l’écoute des conférences de carême de Lacordaire et des chantres de la chapelle Sixtine, des vertus de l’éloquence, autre clef de son esthétique.
À son retour à Paris en 1843, il fut nommé Maître de chapelle à l’Église des Missions étrangères. Ses tentatives pour forcer les portes des théâtres restèrent si vaines qu’il songea à se consacrer à la musique d’église, voire à entrer dans les ordres. Pauline Garcìa Viardot lui donna sa chance en mettant comme condition à son réengagement à l’Opéra la création d’un ouvrage de Gounod dont elle serait l’héroïne… Las, les succès médiocres de Sapho (1851), malgré sa fin sublime, puis de La Nonne sanglante (1854) à l’Opéra firent douter de ses dons pour la musique dramatique, jusqu’à ce que la création du Médecin malgré lui (1858), sur la scène plus intime du Théâtre-Lyrique, révèle ce qu’il pouvait apporter dans un genre moins monumental que le « Grand Opéra ».
Ses librettistes étaient Jules Barbier et Michel Carré, poètes et hommes de théâtre à la plume alerte. Grâce à eux, Gounod sut donner à ses œuvres, et spécialement à l'effusion amoureuse, une note de fraîcheur inattendue et une incomparable justesse d'accent. Faust (1859) n’est pas le fruit des circonstances : Gounod l’a porté en lui pendant vingt ans. Il avait découvert la pièce en 1839. « Cet ouvrage ne me quittait pas, notera-t-il dans ses Mémoires, je l'emportais partout avec moi, et je consignais dans des notes éparses les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra ».
Gounod fut moins heureux avec La Reine de Saba (1862), malgré la qualité des airs, mais se dédommagea avec Mireille (1864) d’après le chef-d’œuvre de Mistral. Au printemps 1863, le poète l’avait pressé de séjourner près des lieux mêmes — les Baux, la Crau — pour saisir le contexte des amours contrariées de la fille du riche Ramon et de Vincent, l’humble vannier. Pour composer Roméo et Juliette, au printemps 1865, Gounod se fixa à Saint-Raphaël : « Je travaille soit chez moi, soit dehors, sur le bord de la mer qui est pour moi un vrai collaborateur. J’entends chanter mes personnages avec autant de netteté que je vois les objets qui m’environnent, et cette netteté me met dans une sorte de béatitude ».
Les trois derniers opéras de Gounod ne connurent pas la consécration immédiate que Roméo et Juliette rencontra en 1867 : de Cinq-Mars (1877) la postérité n’a retenu qu’un air (« Nuit resplendissante ») jusqu’à la redécouverte de l’ouvrage ; Polyeucte (1878) attend son heure qui replacera « Source délicieuse » dans son contexte ; enfin, Le Tribut de Zamora (1881) ne subit pas, de loin, l’échec qui le fit plonger dans un injuste oubli.
Cette carrière théâtrale chaotique tient au fait que le domaine de prédilection de Gounod était l'intimité, et ses mélodies ont autant de mérite à assurer sa gloire que sa musique dramatique. Ravel affirmait qu’il fut « le véritable instaurateur de la mélodie en France [...] qui a retrouvé le secret d'une sensualité harmonique perdue depuis les clavecinistes ».
Gounod a publié près de cent cinquante mélodies, dont près d’un tiers en anglais et une quinzaine en italien écrites lors de ses années londoniennes, de l’automne 1870 au printemps 1874. Toutes sont intéressantes car non seulement il a souvent choisi de bons poètes — Hugo, Musset, Gautier, Lamartine, jusqu'à Racine, La Fontaine, Baïf ou Ronsard — mais encore il leur a rendu justice grâce à une légèreté de touche qui exalte les vers sans s'appesantir et conserve la souplesse de la langue.
La musique sacrée occupe une place majeure dans sa production, au début et à la fin de sa carrière. Seule connue ou peu s'en faut parmi une vingtaine de messes, celle qu'il destina à la fête de Sainte Cécile (1855) n'est cependant pas représentative. C'est, dirait-on, une messe sinon d'apparat du moins de concert, où les quelques allusions au plain chant dans le Kyrie et le Benedictus ne semblent là que pour rehausser les effusions d'un lyrisme chaleureux et ensoleillé.
Trois messes de requiem (1842, 1873, 1891) jalonnent sa carrière marquée par la faveur constante dont jouirent ses deux symphonies (à l’inverse de ses cinq quatuors), une centaine de motets, des chœurs et trois oratorios : Tobie, Rédemption et Mors et Vita créé à Birmingham le 30 août 1885 et dont il expliqua le titre : « La mort n'est que la fin d'une existence qui meurt un peu chaque jour. Mais c'est le moment premier et, en fait, la naissance de ce qui ne meurt jamais. » Gounod franchit le seuil le 18 octobre 1893.
Gérard Condé