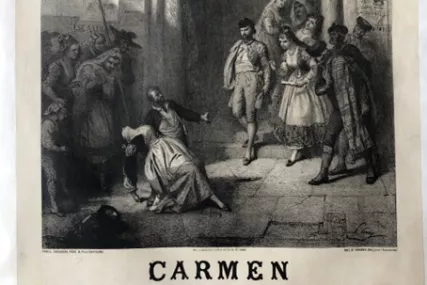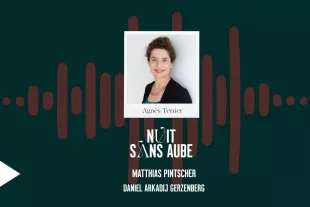Les chanteurs d’opéra-comique devenus acteurs
Quand le cinéma commence à se développer, les membres de la troupe de l’Opéra-Comique sont parmi les premiers à devenirs acteurs muets, et même de vraies stars du cinéma. Galerie de portraits.
Lucien Muratore, ténor qui a débuté à l’Opéra-Comique avant de devenir une star internationale du chant, tourne en 1914 avec sa compagne Lina Cavalieri, elle aussi soprano star, une Manon de Massenet muette sous la direction de Herbert Hall Winslow. Si l’idée de filmer un opéra-comique sans le son peut paraître absurde, il faut la resituer dans le contexte du star-system lyrique précurseur du star-system cinématographique : Muratore et Cavalieri sont l’objets d’un culte des divas, le divisme, et le cinéma passe alors pour un objet de collection de plus. Muratore poursuit ensuite une carrière dans d’autres films : Le Chanteur inconnu (1931), La Voix sans visage (1933) ou Le Chant du destin (1936).

Mme Lina Cavalieri et M. Muratore dans un film de Manon, photographiées publiées dans la revue Musica n°142, juillet 1914, p. 144 © Bibliothèque des Arts Décoratifs
Une carrière semblable a mené la basse Vanni-Marcoux au cinéma : ayant débuté salle Favart en 1914, créateur français de Gianni Schicchi de Puccini, puis professeur d’opéra-comique au Conservatoire de Paris entre 1936 et 1943, il a joué dans Don Juan et Faust (1922), Le Scandale (1923), Le Miracle des loups (1924) et Sans famille (1934) de Marc Allégret.
La basse Jean Aquistapace, grand Scarpia de Tosca, a pour sa part mené une carrière bien plus importante au cinéma qu’à l’Opéra-Comique : entre 1932 et 1952, il joue dans une trentaine de films pour Jean Renoir, Marcel L’Herbier ou Abel Gance, dont une Fille de madame Angot (1935) d’après l’opéra-comique de Lecocq.
L’Écossaise Mary Garden, qui a créé le rôle de Mélisande à l’Opéra-Comique et y a chanté tous les premiers rôles de soprano, joue dans une Thaïs (1917) d’après l’opéra-comique de Massenet ainsi que dans The Splendid Sinner (1918), un film perdu.

Mary Garden en Mélisande, 1908 © LoC
Le ténor José Luccioni, qui a intégré la troupe en 1933, joue dans quelques films dont Noël (1946), Colomba (1948) d’après Mérimée et Le Bout de la route (1949) d’après Giono, tous les deux d’Émile Couzinet.

Affiche de Colomba (1948)
Le ténor Paul-Henri Vergnes, qui débute salle Favart en 1933, apparaît aussi dans le film Mireille de René Gaveau et Ernest Servaes sorti la même année, inspiré du succès lyrique de Gounod qui triompha à l’Opéra-Comique à partir de 1874.

Affiche de Mireille (1933)
ZOOM : Jean Périer (1869-1954)
« Jean Périer, ce n’est pas un baryton, c’est un artiste ! […] "Artiste", Jean Périer l’est et l’a toujours été d’abord, et indépendamment du mode d’expression. De ses instincts, de ses goûts, de son éducation, sa personnalité d’artiste s’est dégagée et développée comme une force naturelle. Tournée du côté du théâtre, elle est tout de suite affirmée par quelque chose qui est l’essence même de l’art : la vérité. » (Henri de Curzon, Croquis d’artistes, février 1954)

Jean Périer, Atelier Nadar, env. 1890-1904 © Bibliothèque nationale de France
La tessiture de baryton de Jean Périer ne suffit pas à le définir. Créateur des rôles de Pelléas (Pelléas et Mélisande, Debussy, 1902), de Landry (Fortunio, Messager, 1907), de Ramiro (L’Heure espagnole, Ravel, 1911) et de Mârouf (Mârouf savetier du Caire, Rabaud, 1914) à l’Opéra-Comique, mais aussi de Florestan (Véronique, Messager, 1898), du rôle-titre de Don Procopio (Bizet, création posthume, 1906) et de Duparquet (Ciboulette, Hahn, 1923), il est également et simultanément comédien et acteur. Son goût du parlé-chanté qu’il développe lorsqu’il est membre de la troupe de l’Opéra-Comique lui permet de distiller sa qualité de « maître de la déclamation lyrique » (France-soir, 5 novembre 1954) dans la comédie et le cinéma.

Jean Périer dans L’Heure espagnole, Atelier Nadar, 1911 © Bibliothèque nationale de France
Lettre de Claude Debussy à André Caplet, 23 juin 1913 : « Périer abandonne, paraît-il, l’Opéra-Comique pour retomber dans les bras que lui tend la Comédie ! Alors, si c’est possible, j’en parlerai à Carré [le directeur de l’Opéra-Comique], sans cela Dieu sait quel phénomène il va me proposer ? Peut-être en profitera-t-il pour ne plus jouer du tout Pelléas ? »
Il est notamment le comte Almaviva dans Le Barbier de Séville, diffusé par Pathé en juin 1910, aux côtés de Georges Berr (Figaro) et de Jeanne-Clémentine Bertiny (Rosine), de la Comédie-Française, et Lescaut dans le Manon de Paul Gavaut, entouré d’Émile Dehelly (des Grieux) de la Comédie-Française et de Marthe Régnier (Manon) du Théâtre de la Renaissance, mais aussi Mister Flow (Siodmak, 1935), Le Roman de Werther (Max Ophuls, 1938). Dans Le Comédien, film réalisé en 1948 par Sacha Guitry et consacré à la vie de son père, Lucien Guitry, Jean Périer joue son propre rôle, et Sacha Guitry celui de son père.

Le Barbier de Séville, 1923 © Cinémathèque royale de Belgique
Autres cas de figure
Les échanges artistiques entre le cinéma et l’opéra-comique ont pris des chemins plus surprenants que la conversion de chanteurs en acteurs. Quelques danseuses du ballet de l’Opéra-Comique ont brillé à l’écran : Régina Badet, après avoir dansé dans Lakmé et Ariane et Barbe-Bleue, tourne une douzaine de films entre 1908 et 1922, entre autres Le Retour d’Ulysse (1909) et Carmen (1910) d’André Calmettes, le réalisateur qui eut l’idée de demander à Saint-Saëns une partition pour L’Assassinat du duc de Guise (1908).

Photographie de Regina Badet par Henri Manuel, 1ère moitié du XXe siècle © Wikimedia Commons
De tous les sociétaires de l’Opéra-Comique, c’est la danseuse Stacia Napierkowska, Polonaise d’origine, qui connut la plus éclatante destinée cinématographique. Repérée par Albert Carré, célèbre directeur de l’Opéra-Comique, elle entame en 1908 une carrière de vingt ans qui la consacre comme partenaire régulière de Max Linder, la plus grande star du cinéma muet français, et de Mistinguett. Elle tourne à plusieurs reprises sous la direction de Michel Carré, neveu d’Albert. Érigée en sex-symbol, elle captive le public dans les rôles de femmes orientales et puissantes : La Zingara (1910), Semiramis (1911), Esmeralda dans Notre-Dame de Paris (1911), la danseuse Djali dans Venus Victrix (1917) ou encore la reine Antinea de L’Atlantide (1921), inquiétante collectionneuse de maris.
Hope Hampton offre un parcours inverse : la Texane triomphe à l’écran dans les années 20 dans les rôles de femme fatale ou de flapper (A Modern Salome, 1920 ou The Gold Diggers, 1923) avant d’entamer une carrière de chanteuse. Elle débute ainsi à l’Opéra-Comique le 5 juillet 1929 en Manon, où elle est jugée une parfaite interprète du rôle, unissant « en la même personne ce qui peut plaire aux yeux et charmer l’oreille » (Comoedia, 7 juillet 1929).
L’exemple de Hope Hampton semble indiquer que le lien entre opéra-comique et cinéma est valable aussi outre-Atlantique. Il se confirme en tout cas avec Geraldine Farrar, grande interprète américaine du répertoire français (Carmen, Mignon, Manon) qui entame en 1915 une carrière au cinéma avec Carmen, adaptation muette de l’œuvre de Bizet par Cecil B. DeMille. Elle est restée célèbre pour son rôle dans Jeanne d’Arc (1916) du même DeMille.
Max Dearly, acteur et metteur en scène français, qui a tourné avec Napierkowska, a aussi chanté dans La Fille de Madame Angot à l’Opéra-Comique le 28 décembre 1918 dans une représentation au bénéfice des œuvres de guerre, sous la direction de Reynaldo Hahn.
Enfin, quelques projets non aboutis mais évoqués par la presse de l’époque témoignent de cette époque de croisements fertiles entre l’opéra-comique et le cinéma : la danseuse Régina Badet aurait dû faire une Carmen avec Max Deary, qui a été tournée mais jamais diffusée ; de même la soprano Lily Pons, grande interprète de Lakmé, aurait dû tourner une Manon Lescaut sous la direction de Raymond Bernard aux côtés du ténor de l’Opéra-Comique José Luccioni en 1938, mais le projet est vraisemblablement abandonné.
La question du geste : le legs du mime
La catégorie théâtrale que le cinéma muet met en jeu à ses débuts est le mime, ou plutôt la pantomime (un spectacle où tout est mimé). Or la gestuelle déclamatoire en vigueur à l’époque à l’Opéra et à la Comédie-Française, telle qu’on l’enseigne au Conservatoire dans les classes de « déclamation lyrique » et « déclamation dramatique », est loin de convenir à la caméra. Cet art déclamatoire, centré sur la parole, se donne pour but d’accompagner les mots par un répertoire figé de gestes larges et spectaculaires destinés à être vus de loin, et à exprimer des sentiments nobles voire surhumains. Tout au long du XIXe siècle, en effet, à défaut de metteur en scène, ce sont les chanteurs qui décident de leurs gestes. Un régisseur dicte leurs déplacements sur scène, mais pour le reste tout revient à leurs réflexes. Des répertoires de gestes très codifiés sont édités dans les manuels : les talons jamais collés, le bras tendu mais jamais en ligne droite, le point sur le front pour exprimer la douleur, etc. Les chanteurs avancent pour les airs sur le « nez de scène » afin de faire passer leur voix et de s’adresser directement au public – au mépris de la situation dramatique.

Reprise d’Hernani à la Comédie-Française, dessin de Dupain gravé par Gillot, 1877 © Paris Musées
C’est ce que parodie Chaplin dans la scène finale de sa Carmen : la confrontation a lieu face à la caméra, Carmen entortille sa coiffe pour exprimer son angoisse, elle se plaque au mur dans une expression de terreur, il l’attrape par le chignon et se place devant elle pour cacher le coup, puis l’accompagne dans une chute lente où Carmen prend le temps de bien se tourner vers le public en modifiant la position de ses jambes ; José s’enfonce le poignard sous l’aisselle et meurt en écrasant Carmen de tout son poids, et en repositionnant son bras.
Ce jeu stéréotypé est le jeu déclamatoire que le cinéma va révolutionner. Or, à l’Opéra-Comique, une révolution de ce genre est déjà en marche à la fin du XIXe siècle, quand Albert Carré prend la tête de la maison en 1898. Carré sort alors de treize ans de direction du Vaudeville, où le jeu est plus libre, plus quotidien, et où la déclamation n’impose pas sa loi comme dans les tragédies de la Comédie-Française. Carré y dirigeait régulièrement les mises en scène. C’est pourquoi, quand il arrive à l’Opéra-Comique, il épure le mime des chanteurs de la troupe. Quand il met en scène la création française de La Bohème de Puccini, en 1898, il exige la plus grande sobriété :
« En raison du caractère intime de la pièce, j’avais exigé de mes protagonistes […] un jeu aussi dépouillé que j’aurais pu le demander à mes ex-pensionnaires du Vaudeville. Au début, chanter un duo assis, lancer telle réplique de dos, telle phrase du fond du théâtre parut singulier à des chanteurs habitués à raconter toutes leurs petites affaires au chef d’orchestre. Mais très vite, ils me comprirent et me suivirent. » Souvenirs de théâtre…, Paris, Plon, p. 226

Albert Carré à son bureau, photographie parue dans la revue Musica n° 55, avril 1907 © Bibliothèque des Arts Décoratifs
Il perçoit que l’œuvre de Puccini est un drame du quotidien, qui doit être joué avec un objectif de réalisme plus que d’élévation tragique. Cette révolution du jeu préfigure le jeu cinématographique, où la proximité de la caméra impose de laisser de côté les artifices grandiloquents.
Un autre exemple : Carré dirige Jean Périer dans le drame lyrique Le Chemineau, qui comporte une scène violente où le personnage de Périer saute à la gorge d’un autre personnage avant de tomber inanimé car il est trop faible. Carré choisit de traiter la scène avec réalisme, et les critiques soulignent la retenue de Périer dans cette scène qui pourrait donner lieu à une gestuelle outrée : « Dans la scène mélodramatique où il prend maître Pierre à la gorge, [Jean Périer] a été admirablement tragique, sans excès dans l’accent ni le geste, avec une simplicité et une sobriété rares. » Pierre Lalo, Le Temps,12 novembre 1907.

Jean Périer dans Le Chemineau, 1907 © Ministère de la Culture
On pourrait dire que, sous l’influence de Carré, le jeu de Périer se fait cinématographique plus que déclamatoire. Le naturel de son jeu et de son mime se retrouve dans ses films après la révolution du parlant : « Jean Périer possède ce métier au point qu’il lui est devenu si aisé que c’est sa propre nature qui le conduit et que ses moindres gestes ont la précision de réflexes. Il est parvenu à clarifier le bavardage de cinéma parlant. Point de tirades ou de grandes phrases, mais des mots qui scandent et ponctuent des impressions et des silences qui, grâce à lui, sont plus angoissants que des cris douloureux. » Excelsior, 29 mai 1931

Les interprètes de Fidès, Mlle Laus et M. Rossi, photographie parue dans Le Figaro, 27 février 1894
Ainsi la proximité entre opéra-comique et cinéma passe aussi par la question de la pantomime. Cet art de raconter uniquement par le mime est non seulement historiquement indissociable de la troupe de l’Opéra-Comique, mais trouve encore sa place dans la salle Favart à la fin du XIXe siècle. En 1894, en effet, alors que Léon Carvalho est le directeur, on représente un « drame mimé » intitulé Fidès. Cette pantomime, donc sans paroles ni chant, accompagnée d’une musique de Georges Street, est un vrai péplum : Fidès est une jeune vierge chrétienne condamnée au bûcher par Néron. Il n’est pas impossible de voir dès lors la proximité d’une telle œuvre avec le cinéma qui commence à se développer. Le critique Arthur Pougin note dans sa recension que, contrairement à ce que certains spectateurs affirment, il n’est pas contraire à l’esprit des lieux d’y représenter une pantomime :
« Je n’ai pas à défendre M. Carvalho de ses attentats répétés contre l’opéra-comique ; mais je croirais volontiers qu’il n’est pas en contradiction avec son cahier des charges en jouant des pièces dépourvues de tout espèce de texte. J’ai souvenance que jadis, et jusqu’aux premières années de ce siècle, le théâtre Favart, successeur direct et légitime de l’ancienne Comédie-Italienne, avait un corps de ballet fort bien monté, composé de douze danseurs et de douze danseuses, à l’aide duquel il représentait de temps à autre quelques divertissements dansés et quelques petits ballets-pantomimes. Il se peut donc très bien que l’Opéra-Comique conserve la même faculté. » Le Ménestrel, 4 mars 1894
ZOOM : Georgette Leblanc, chanteuse, actrice et mime

Georgette Leblanc, 1921, anonyme © Wikimedia Commons
La carrière de Georgette Leblanc (1869-1941) permet de mettre en évidence le rôle du jeu dans les liens entre opéra-comique et cinéma. Cette Normande, sœur du romancier Maurice Leblanc, intègre la troupe de l’Opéra-Comique en 1893. Femme lettrée et cultivée, elle rencontre le tout Paris littéraire et intellectuel, et devient la maîtresse de Maurice Maeterlinck, poète symboliste belge, qui a su s’inspirer parfois des lettres de sa talentueuse amante. Sa brillante carrière est marquée par un échec : Debussy refuse qu’elle soit la créatrice de Mélisande, alors que le livret de Pelléas est de Maeterlinck.
Son jeu est régulièrement cité et remarqué pour son « intelligence ». Jeune, elle rencontre Massenet, qui l’encourage à devenir chanteuse, et Sarah Bernhardt, qui lui dit qu’elle pourrait être actrice. Elle qui ne sort d’aucun conservatoire et qui affirme son indépendance devient la créatrice d’Ariane dans Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas (1907), et la courageuse interprète des poèmes de son mari et de l’avant-garde poétique de l’époque. Stéphane Mallarmé compare son jeu à celui d’un mime : « le vol nu de ses bras, des attitudes que je nommerai d’une mime musicale, sauf qu’elle-même est la source lyrique et tragique. » (La Revue blanche, 1er mars 1898) Dans ses mémoires, Georgette explique elle-même que son jeu novateur lui vaut l’incompréhension, et parfois l’hostilité, d’une partie du public : « mes costumes, mes gestes, mon allure […] déconcertaient les esprits routiniers et enchantaient les autres. » (Souvenirs, Paris, 1931, p. 164) Elle est vraisemblablement bien plus une actrice qu’une chanteuse : c’est pour cela que Debussy la refuse. Fauré note, lors de la création d’Ariane, qu’elle n’a pas la dimension vocale du rôle : « Ce rôle est interprété par Mme Georgette Leblanc de façon admirable au point de vue du jeu et de la plastique, d’une manière moins complètement satisfaisante au point de vue vocal ; j’entends par là que si Mme Georgette Leblanc chante fort juste et fort bien, le volume de sa voix ne suffit pas toujours à faire parvenir jusqu’aux auditeurs un texte qu’il est indispensable qu’on entende mot par mot. » (Le Figaro, 11 mai 1907). Les commentaires des observateurs de l’époque dessinent le portrait d’une actrice douée, jamais excessive, qui joue sans déclamer, et qui même est étrangère à l’art de la déclamation.
Georgette Leblanc est l’interprète du premier rôle dans le film d’avant-garde de Marcel L’Herbier L’Inhumaine (1924), une œuvre à l’esthétique presque abstraite, marquée par le cubisme et l’art déco, à laquelle collaborent entre autres Fernand Léger, Paul Poiret, Robert Mallet-Stevens et Darius Milhaud. Elle joue le rôle de Claire Lescot, « cantatrice célèbre, femme étrange, riche, affranchie » qui réunit dans ses soirées des personnalités marquantes venues du monde entier. Or dans ce film muet, elle excelle dans une interprétation étonnamment moderne, très délicate et mesurée pour la caméra, marquée par sans doute par sa familiarité avec le « théâtre du silence » de Maeterlinck. Alors que son rôle est celui d’une fantasque cantatrice, elle ne tombe dans aucun des excès du jeu déclamatoire, tout en se servant de son regard et de ses quelques gestes pour renforcer le mystère de son personnage.
En comparaison le jeu de son partenaire Jaque-Catelain, pourtant acteur de cinéma professionnel, paraît beaucoup plus figé, de même dans cette conversation avec un autre personnage. Elle n’hésite pas à jouer dos à la caméra.
Son jeu passe par les mouvements de sa tête et son regard, alors que ses bras restent globalement immobiles.
Georgette Leblanc incarne ainsi l’infléchissement du jeu qu’a introduit le cinéma et auquel ont contribué l’Opéra-Comique et son directeur d’alors, Albert Carré