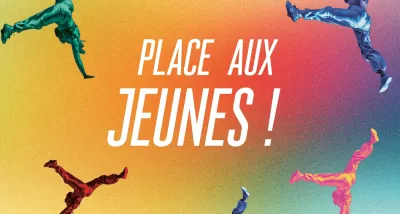Il s’agit de la quatrième production d’iphigénie en tauride que vous dirigez. Comment abordez-vous cette oeuvre ?
Iphigénie en Tauride, chef-d’oeuvre de Gluck, nous étreint d’emblée par la densité de son propos et par l’éloquence de sa musique. Ce grand réformateur de l’art lyrique consacra la fin de sa carrière à dépouiller l’opéra de tout artifice, pour n’en conserver que la vérité et la simplicité essentielles. Berlioz, qui se sentait l’héritier de Gluck, écrivait qu’il « fut le premier à comprendre que la musique dramatique ne doit pas être un simple ornement, mais l’âme même de l’action. Il innova presque en tout ; doué d’un sentiment d’expression extraordinaire, il donna aux passions un langage vrai, profond et énergique. On pourrait regarder Gluck comme le Shakespeare de la musique. »
Dans Iphigénie, Gluck nous dépeint le déracinement, l’errance et la douleur. Autant d’images qui traversent les siècles et les civilisations. Mais les héros tragiques nous bouleversent par leur résistance. À l’inverse des drames lyriques qui nous émeuvent par la fragilité des personnages (Pamina, Violetta, Mélisande…), Iphigénie en Tauride nous révèle une héroïne faisant face à sa destinée tragique, debout, les yeux ouverts. Gluck porte à la perfection ce style nouveau.

Les répétitions de Iphigénie en Tauride aux Ateliers Berthier (2025) © Stefan Brion
Se posant en réformateur, comment Gluck se saisit-il des formes lyriques alors en vigueur ?
À cette époque, la France et l’Italie sont en plein débat sur ce qui devrait primer dans l’opéra : « Prima la musica, dopo le parole? Prima le parole e poi la musica? » Gluck s’insurge contre « tous ces abus qui, depuis si longtemps, défigurent l’opéra italien, et du plus beau des spectacles en font le plus ridicule et le plus ennuyeux ». Il veut « ramener la musique à sa véritable fonction : seconder la poésie dans l’expression des sentiments et des situations, sans interrompre l’action ni la refroidir par des ornements inutiles. La simplicité, la vérité et le naturel sont les grands principes du beau. »
Les longs airs da capo sont bannis. Gluck proscrit la virtuosité pour elle-même : il exige la justesse du sentiment, permet la fusion de la parole et de la musique. Une note par syllabe, et non plus de vocalises démonstratives et de mélismes interminables.
Il réforme également la structure dramatique du genre lyrique, ouvrant la voie au Gesamtkunstwerk (oeuvre d’art totale) cher à Wagner. Gluck abolit le recitativo secco (accompagné au seul clavecin) et confie aux interprètes et à l’orchestre une éloquence souveraine. Voyez la fin de la tempête introductive, « Le calme reparaît », où Gluck compose un fondu enchaîné avec le récitatif d’Iphigénie, répétant cette même phrase au début du récit. Ainsi, la frontière entre récitatif et air s’estompe… Plus tard, dans le troisième acte, Oreste intervient à deux reprises au milieu de l’air de Pylade, « Ah, mon ami, j’implore ta pitié ». Sommes-nous dans un air, ou un duo, ou un récitatif ? Peu importe, c’est la scène qui prime.
Peut-on aborder iphigénie en tauride sans connaître toute la saga des atrides ?
Cette production s’ouvre par l’ouverture d’Iphigénie en Aulide de Gluck, opéra racontant le sacrifice d’Iphigénie par son père Agamemnon. Puis un prologue théâtral écrit par Wajdi Mouawad nous invite dans la Tauride d’aujourd’hui – la Crimée – avant de remonter le temps, celui de l’Antiquité grecque et des Atrides.

Les répétitions de Iphigénie en Tauride aux Ateliers Berthier (2025) © Stefan Brion
Quelles sont les différences entre expression dramatique et expression tragique ?
La musique de Gluck est d’une puissance tragique bouleversante. Dans la tragédie, joie et douleur atteignent une intensité égale : la musique n’illustre pas, elle révèle.
Prenons quelques exemples. Gluck, grand maître de l’épure, de la clarté et de la concision, dépeint l’essence de la déclamation tragique : la même musique peut alors exprimer la douleur ou la joie absolue. Ainsi « J’ai perdu mon Eurydice, rien n’égale mon malheur » pourrait se chanter sur la même mélodie que « J’ai revu mon Eurydice, rien n’égale mon bonheur. » Sa musique transcende le sens immédiat pour en atteindre l’essence. Chez Mozart, l’ouverture de Don Giovanni nous plonge immédiatement dans le drame de l’histoire, nous fait entendre les cris des Enfers, illustre la punition divine, et nous fait ressentir les angoisses et la frénésie du personnage principal. Chez Gluck, au contraire, dans l’ouverture d’Alceste, en ré mineur elle aussi, la musique n’est jamais narrative ; elle ne dépeint pas un sentiment mais plutôt un état, une densité, une gravité qui nous portent et nous élèvent.
Comment rendre les spectateurs sensibles à la musicalité du texte et à la théâtralité de l’écriture musicale ?
La musique de Gluck vit de la résonance poétique du verbe, de la justesse sonore de chaque syllabe. Il faut respecter scrupuleusement les indications de la partition, les rythmes, les silences, la couleur de chaque consonne et de chaque voyelle. Ainsi, la beauté de la poésie et la puissance d’expression résonnent en nous, comme gravées en lettres majuscules.
Écoutez ces allitérations : « De forfaits sur forfaits,quel assemblage affreux ! » Ou encore « De sinistres terreurs est sans cesse obsédée… » et « Si sur ces bords sanglants le Ciel fixa nos pas » : six s par vers, plus encore que dans le célèbre « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » d’Oreste dans Andromaque de Racine.
Dans Iphigénie en Tauride, la beauté vocale laisse la place à la vérité théâtrale. Observez le choix des voyelles (i, in, en) pour illustrer la douleur d’Iphigénie : « Mêlez vos cris plaintifs à mes gémissements, / Vous n’avez plus de roi, je n’ai plus de parents. » Ainsi, le mot est musique ! Gluck pensait théâtre avant de penser musique. Dans le grand air d’Iphigénie, la musique, d’une simplicité presque archaïque, déploie une puissance expressive inouïe : les syncopes de violons, superposées aux accents sur les temps faibles aux bassons et violoncelles et aux sanglots étouffés des altos, accompagnent la plainte déchirante du hautbois, et l’âme d’Iphigénie se met à vibrer. Paradoxalement, cette économie de moyens confère à son art une modernité saisissante.
Iphigénie en tauride est donc le couronnement d’une vie.
Gluck est au sommet de son art dans cette oeuvresynthèse : il y intègre plus de quinze extraits de ses opéras et ballets antérieurs (La Clémence de Titus, Télémaque, Pâris et Hélène, Sémiramis, L’Île de Merlin…) pour en extraire la substance la plus épurée.
« À la recherche de la beauté, toujours privilégier la vérité de l’expression. » Cet adage de Gluck résume à lui seul son art, dans lequel Iphigénie en Tauride puise son incandescence.

Les répétitions de Iphigénie en Tauride aux Ateliers Berthier (2025) © Stefan Brion
Avec
Direction musicale, Louis Langrée et Théotime Langlois de Swarte • Mise en scène, Wajdi Mouawad • Avec Tamara Bounazou, Theo Hoffman, Philippe Talbot, Jean-Fernand Setti, Léontine Maridat-Zimmerlin, Fanny Soyer, Lysandre Châlon, Anthony Roullier • Choeur, Les Eléments • Orchestre, Le Consort
Iphigénie en Tauride
Tragédie lyrique en quatre actes | Livret de Nicolas-François Guillard | Représentée pour la première fois à l’Académie royale de musique (Paris) le 18 mai 1779.