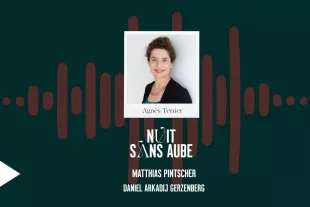Avant-dernier opéra de Rossini, et unique comédie en français de ce compositeur, Le Comte Ory fut joué sans discontinuité à l’Opéra de Paris de sa création le 22 août 1828 jusqu’en 1884, date à laquelle il quitta l’affiche. Il s’agit d’un des plus grands succès de l’Opéra, ce qu’on oublie souvent lorsqu’on réduit le répertoire de ce théâtre aux grands opéras historiques de Meyerbeer et Halévy, connus de nous essentiellement au travers du mélange de haine et de fascination qu’ils inspirèrent à Richard Wagner.
Le Comte Ory est en partie dérivé du dramma giocoso en un acte Il viaggio a Reims que Rossini avait écrit à l’occasion du retour de Charles X à Paris, après son couronnement à Reims (1825). Il est, pour l’acte I, le rifacimento de cette oeuvre italienne de circonstance – ce à quoi Rossini avait déjà procédé pour produire à l’Opéra Le Siège de Corinthe (1826) et Moïse (1827). Mais pour l’acte II, Le Comte Ory est la première composition de Rossini en français, avant Guillaume Tell (1829). Pour toutes ces raisons, Le Comte Ory est une œuvre singulière, très éloignée des comédies du canon italien de Rossini, comme Il barbiere di Siviglia. C’est enfin et surtout une oeuvre d’esprit français, et qui fut acceptée comme telle, tout au long du XIXe siècle, par le public parisien.
Il peut surprendre qu’une oeuvre comique ait été donnée sur la scène de l’Académie royale de musique – le nom officiel de l’Opéra de Paris – et non sur celle de l’Opéra-Comique. De fait, Le Comte Ory est entièrement mis en musique et ne comporte pas de dialogues parlés. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, à chaque théâtre parisien était attribué un genre précis, et seul l’Opéra avait le privilège de faire représenter des oeuvres – en français – entièrement chantées.
À côté du genre sérieux, appelé « tragédie en musique » du XVIIe au XVIIIe siècle, puis « tragédie lyrique » après la réforme de Gluck, enfin « grand opéra » au XIXe siècle, l’Opéra faisait appel à des oeuvres moins ambitieuses, les « petits opéras ». Ceci lorsque le monarque se désintéressait de l’opéra – ce qui était le cas de Charles X – ou quand le théâtre affrontait des difficultés financières. Ces conditions furent précisément celles de la genèse de l’oeuvre, de 1827 à 1828, et Le Comte Ory peut être considéré comme la solution brillante à une équation complexe, trouvée par Émile Lubbert, le directeur de l’Opéra.
De 1819 à 1827, le Théâtre-Italien, institution centrale dans la vie culturelle parisienne, fut placé sous la tutelle de l’Opéra suite à la faillite de l’administration d’Angelica Catalani. Ce qui, à l’origine, était perçu comme une corvée pour l’Opéra ne tarda pas à se révéler comme une opportunité providentielle. Les œuvres de Rossini commençaient tout juste d’être représentées en France et connaissaient un succès grandissant. Et il se trouve que la politique en vigueur n’autorisait leur représentation qu’au Théâtre-Italien. L’engouement pour Rossini tourna vite à la frénésie : en 1825, la moitié du répertoire du Théâtre-Italien était constitué de ses oeuvres ! Le phénomène était certes général en l’Europe à l’époque. Mais pour comprendre l’intensité de la fièvre parisienne, il faut se souvenir que l’opéra italien avait été interdit en France pendant l’Ancien régime. Seuls le dynamisme et la fraîcheur de la musique de Rossini pouvaient étancher la soif de nouveauté des Parisiens. L’Opéra bénéficiait ainsi indirectement de son triomphe au Théâtre-Italien.
La fin de l’administration commune des deux maisons, annoncée pour 1827, risquait du coup d’être une catastrophe pour les finances de l’Opéra. Lubbert et le vicomte de La Rochefoucauld, directeur des Beauxarts, mirent donc tout en oeuvre pour s’attacher les services de Rossini. Ils acceptèrent de considérer Le Siège de Corinthe et Moïse comme des oeuvres originales, ce qu’elles n’étaient pas. La manoeuvre était habile : la loi française prévoyait d’accorder une pension à vie à tout compositeur de trois oeuvres ayant chacune atteint quarante représentations. Il devenait donc crucial pour Rossini de composer au plus vite un « troisième » opéra.
Il entama simultanément Le Comte Ory et Guillaume Tell. Or la production de Guillaume Tell devait être coûteuse : on envoyait le peintre Ciceri faire des études préparatoires en Suisse pour produire des décors aussi impressionnants que ceux qui avaient assuré le triomphe de La Muette de Portici, en février 1828. C’est donc pour équilibrer ces coûts exorbitants que le choix de l’autre opéra se porta sur une comédie qui, elle, ne nécessitait aucune dépense particulière, son succès reposant essentiellement sur la qualité des acteurs.
Le pari était d’attirer le public avec l’association des deux grands noms du moment, Rossini et le librettiste Scribe, qui « avait quelque chose de piquant ». Chacun adapta une oeuvre précédente : le dramaturge reprit un vaudeville en un acte de 1816, qu’il avait tiré d’une célèbre ballade publiée par Pierre-Antoine de La Place en 1785. À cette matière, que la critique trouvait trop légère, il ajouta non pas une suite mais un prequel, où l’on voit le jeune libertin se déguiser en faux ermite. Il est possible qu’il y ait eu là une allusion au faux prophète du moment, Martin de Gallardon. Mais si l’acte I était nouveau pour Scribe, il était au contraire ancien pour Rossini puisque c’est là qu’on trouve la plupart des numéros dérivés du Viaggio a Reims, y compris le gran pezzo concertato à 14 voix, élargi pour l’Opéra aux dimensions gigantesques d’un ensemble pour 13 voix solistes et double choeur.
Dans l’acte II, ancien pour Scribe, se trouvent en revanche les morceaux nouveaux de Rossini, dont l’introduction où convergent une tempête et la prière des fausses pèlerines, et le trio final, qui rappelle la scène du fauteuil du Mariage de Figaro de Beaumarchais, dans une version beaucoup plus osée. Au milieu de l’acte, le choeur des buveurs connut un succès considérable et rallia même les adversaires de Rossini. L’humour de situation provient directement du vaudeville : le passage de la tourière Ragonde interrompt pour quelques instants la beuverie des chevaliers. On y entend surtout le thème de l’ancienne ballade du Comte Ory sur les mots « Célébrons tour à tour ». Il y a fort à parier que le public de l’Opéra reprenait en choeur cette fameuse chanson. Elle fut en effet, tout au long du siècle, l’une des chansons populaires les plus aimées en France.
Dans cette scène, c’est l’esprit gaulois qui est célébré par Scribe et Rossini, un esprit hérité des trouvères du Moyen-Âge et élevé, chez les critiques littéraires du XIXe siècle, au rang d’emblème de l’esprit national. C’est cet esprit français, où malice et paillardise se mêlent avec légèreté, mais sans vulgarité, qu’il nous est donné de déguster aujourd’hui.
Par Damien Colas
ACTE I
À l’époque des croisades, alors que les châtelains sont partis pour la Terre sainte, Dame Ragonde se retrouve seule gardienne du château de Formoutier où se languit une belle veuve, la Comtesse. Le comte Ory, seigneur aventurier et sensuel, entreprend sa conquête galante avec la complicité de son compagnon Raimbaud, tous deux travestis en prêtres. Au village, Ory découvre, en les confessant, que son page Isolier et la Comtesse sont épris l’un de l’autre. Alors que le Gouverneur dénonce Ory devant La Comtesse, un courrier annonce le retour prochain des croisés. Ory n’a plus que quelques heures pour tenter de s’introduire au château avec ses chevaliers.
ACTE II
De retour au château, la Comtesse autorise Ragonde à accueillir des pèlerines surprises par l’orage. Il s’agit en fait d’Ory et de sa troupe, à nouveau travestis. Sous le nom de soeur Colette, Ory sonde le coeur de la Comtesse : celle-ci affirme son mépris pour le comte libertin. Tandis que les chevaliers ripaillent, Isolier révèle à la Comtesse l’arrivée imminente des croisés. Il comprend immédiatement qui sont véritablement les pèlerines. Soeur Colette vient prier la Comtesse de l’accueillir dans sa chambre pour la nuit. Mais la femme qu’Ory presse dans l’obscurité n’est autre qu’Isolier, avec la complicité de la Comtesse. Confondu par son page, Ory s’avoue vaincu et obtient de s’échapper avec ses hommes. On peut supposer qu’Isolier sera récompensé…